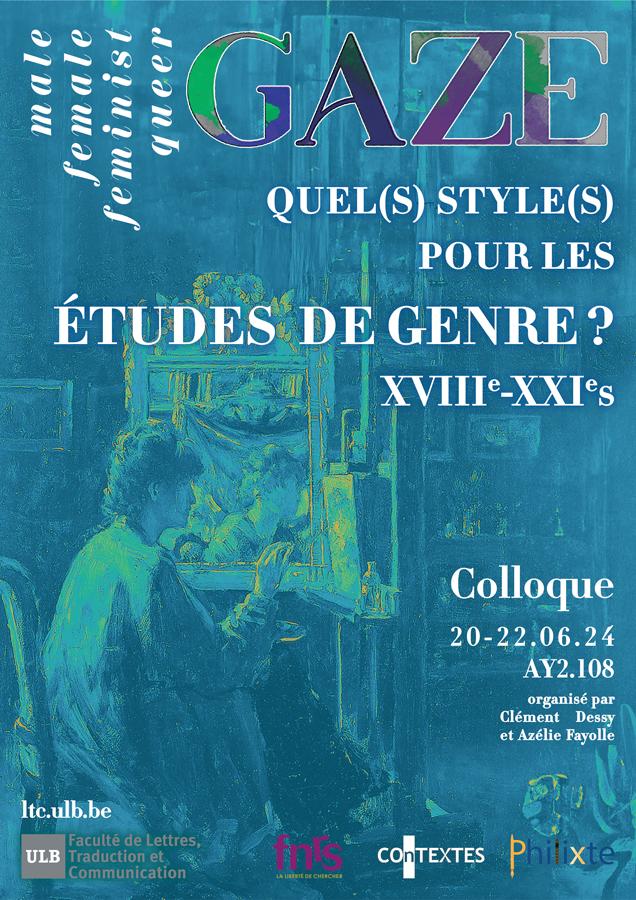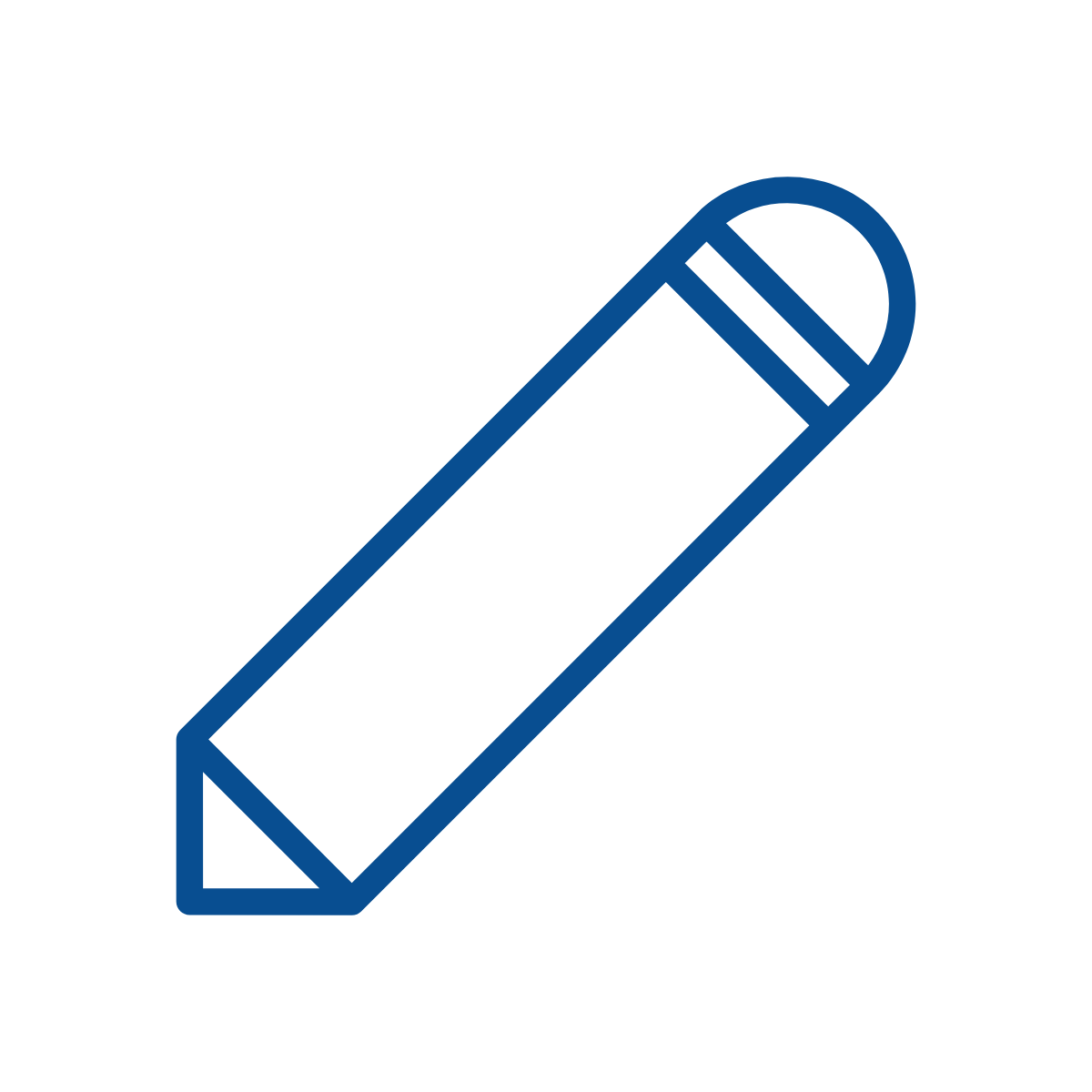- Faculté de Lettres, Traduction et Communication
- Accueil
- Agenda
-
Partager cette page
Colloque "Male gaze female gaze feminist gaze queer gaze… : quel(s) style(s) pour les études de genre ? XVIII-XXIe s"
Nouveau venu dans le vocabulaire des études de style, le concept de gaze connaît une actualité probablement favorisée par l’élargissement du cadre stylistique qu’il propose. Ce colloque propose d’ouvrir les questionnements et les méthodes de poétique et de stylistique au prisme du genre.
La parution de l’ouvrage Le regard féminin. Une révolution à l’écran d’Iris Brey en a permis, dès 2020, une circulation large et nouvelle dans les espaces francophones, par la diffusion du concept de male gaze, initialement forgé par Laura Mulvey en 1975 dans Visual pleasure and narrative cinéma (traduit en 2017 dans Au-delà du plaisir visuel. Féminismes, énigmes, cinéphilie par Teresa Castro et Clara Schulmann, Mimésis). Le succès du concept comme celui de l’ouvrage signalent un intérêt actuel du public, en partie académique, pour des approches des œuvres artistiques intégrant les questions politiques et éthiques contemporaines, en revendiquant une littérature placée au sein de la société. Les questions liées au genre et à leurs interactions, potentiellement violentes, tiennent une place de plus en plus importante depuis #metoo et, pour les études littéraires, l’affaire Chénier (2017). Elles commencent à se faire entendre, depuis les ouvrages militants (comme Une culture du viol à la française : du « troussage de domestique » à la « liberté d’importuner » de Valérie Rey-Robert, Libertalia, 2020) jusqu’aux études plus académiques, comme le montrent, entre autres, les récents Au Non des femmes. Libérer nos classiques du regard masculin de Jennifer Tamas (Seuil, 2023), Des femmes et du style. Pour un feminist gaze d’Azélie Fayolle (Divergences, 2023) ou En finir avec la passion. L'abus en littérature de Sarah Delale, Élodie Pinel et Marie-Pierre Tachet (Amsterdam, 2023).
Depuis le male gaze de Laura Mulvey, les propositions foisonnent : queer gaze, oppositionnal gaze (bell hooks), tender gaze (Muriel Cormican et Jennifer Marston William, introduit en français par Lucie Nizard), feminist gaze, regard lesbien, etc.
L’introduction du concept de gaze dans les discours critiques, notamment amateurs, a l’avantage d’approfondir les critiques thématiques ou cantonnées à la seule représentation de figures opprimées, et son emploi signale une lacune théorique des études littéraires.
Une exploration commune à partir de la littérature en français du XVIIIe siècle à aujourd’hui
Ce colloque propose d’ouvrir les questionnements et les méthodes de poétique et de stylistique au prisme du genre (sans oublier qu’il puisse croiser d’autres oppressions). Si le style a longtemps été compris comme l’empreinte d’une singularité, souvent marquée du sceau du génie et de l’exceptionnalité dans le sillage du romantisme, d’autres approches, comme la sociocritique, permettent de le comprendre aussi comme un marqueur de groupe, inscrit autant dans une dynamique de réappropriation(s) de la langue que dans la construction d’une individualité.
Autrement dit, si, comme l’a déclaré Buffon, « le style est l’homme même », il convient peut-être de se rappeler aussi qu’il n’y a que les écritures de femmes qui ont été aussi systématiquement étudiées au prisme d’une assignation à un genre, quand les virilismes littéraires sont négligés et que d’autres écritures sont disqualifiées pour leur fluidité perçue comme un manque de vigueur et de fermeté, les reléguant en même temps que les supposées écritures féminines. Il ne s’agit pas de raviver ce vieux serpent de mer : le gaze permet plutôt de considérer les rôles sociaux de genre, mis en scène dans les textes, qu’il y ait ou non adéquation avec des identités réelles, dans leur dimension politique (plutôt que sociale ou directement biographique).
Le male gaze littéraire n’est pas ce que serait une écriture des hommes : il traduit en point(s) de vue un positionnement jouissant de la domination masculine, traduite dans l’exploitation des corps féminins à l’écran comme dans les textes, et constitue ainsi une dimension (non exhaustive) d’un style viriliste. Ce gaze peut être repris, comme par Annie Ernaux (non sans difficultés et sans écart : l’inversion des rôles ne suffit pas, comme le montre les difficultés relatées dans Une passion simple) ou Rachilde (qui revendique son antiféminisme et d’écrire comme un homme de lettres). De même, le female gaze ne peut se comprendre comme une inversion du male gaze approprié par des autrices ou des personnages féminins, mais comme une mise en texte proposant d’autres axiologisations.
On le voit : le gaze, comme le genre (littéraire), convoque un imaginaire du genre, ainsi que l’a montré Christine Planté dans « Un roman épistolaire féminin ? Pour une critique de l’imaginaire générique ». Les imaginaires de la langue, théorisés par Gilles Philippe, se retrouvent ici également, dans un imaginaire genré des styles. Le genre constitue en effet un continuum, plus ou moins inconscient, plus ou moins intentionnel, mais qui se trouve conscientisé dans et par le(s) style(s), avec des gradients divers, depuis la réalisation d’un style propre jusqu’à son explicitation dans des métadiscours. C’est dire que le gaze permet de voir comment le texte fabrique son public depuis ces théorisations jusqu’aux réappropriations, revendiquées ou allusives, construisant des généalogies comme des filiations et des communautés.
Ce sont ces théories dont nous voudrions proposer l’exploration commune, à partir de la littérature en français du XVIIIe siècle à aujourd’hui.
- Consulter le programme détaillé
- Il est également possible d'assister à l'évènement en ligne. Merci de vous inscrire auprès de clement.dessy@ulb.be pour obtenir le lien.
Un colloque organisé par Clément Dessy et Azélie Fayolle
L'horaire du colloque varie selon la journée concernée
Bâtiment A - Auditoire AY2.108